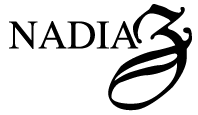À l’âge de 19 ans, la Kabyle Nadia Zouaoui a été arrachée de force à son village de Tazmalt et mariée à un compatriote émigré au Québec. Des années plus tard, elle revient en Kabylie afin de comprendre ce qui, dans sa contrée, freine l’émancipation des femmes. C’est cette quête de sens que met en scène le documentaire Le voyage de Nadiaqu’elle vient tout juste de réaliser avec Carmen Garcia (Argus Films et ONF, 2006).
À bâbord ! — Le voyage de Nadia, est-ce bien le vôtre ? De quelle expérience personnelle êtes-vous partie pour porter à l’écran ce regard critique en parlant des souffrances des femmes dans cette région de l’Algérie – la Kabylie – d’où vous êtes originaire ?
Nadia Zouaoui — L’idée originale du film n’avait rien à voir avec mon histoire personnelle. Je voulais faire un film sur les difficultés que rencontrent les femmes féministes dans les pays musulmans. Des femmes comme Chirine Ebadi, le prix Nobel de la paix, me fascinent, car je sais combien il est pénible et frustrant de se battre dans des sociétés où les mentalités sont machistes et rétrogrades. Je retourne donc dans mon pays d’origine pour parler des femmes de mon enfance à travers mon histoire. Je me suis dit que dans mon village il y a tous les ingrédients pour un tel film.
Toute petite, je ressentais déjà les injustices vécues par les femmes autour de moi : le mariage forcé de mes cousines, l’impossibilité de sortir, les tâches ménagères qui n’incombaient qu’aux filles. Les professeurs du lycée de filles que j’ai fréquenté nous appelaient « le genre faible » au lieu de prononcer le mot « femmes ». Ce mépris pour la femme, je l’ai remarqué à un très jeune âge et, même si tout le monde autour de moi trouvait cela normal, je savais que c’était injuste et je me suis donné la mission de le dénoncer un jour.
ÀB ! — Dans le film, d’entrée de jeu, l’œil de la caméra pointe l’aspect carcéral de la répartition de l’espace entre femmes et hommes. L’agora, ou l’espace public, y apparaît comme une affaire d’hommes strictement.
N.Z. — Très jeune, j’ai été marquée par cet enfermement des femmes. Je n’ai jamais vu mes voisines ou ma mère marcher dans les rues de mon village. C’est comme si elles appartenaient naturellement au décor de leurs cuisines et faisaient partie des meubles de la maison. Cette servitude intériorisée me déconcertait. Nous étions des prisonnières dans nos propres maisons, non parce que nous avions commis des crimes comme de vrais prisonniers, mais parce que nous étions des femmes. Vers l’âge de dix ans, j’envoyais des bouts de papier aux femmes du voisinage où je les invitais à faire une manifestation dans les rues de Tazmalt pour demander le droit de sortir. Personne n’osait mettre le nez dehors le jour venu. Elles me trouvaient bien mignonne avec mes petits bouts de papier et mes rêves de liberté et je ne comprenais pas pourquoi elles ne se joignaient pas à moi. Elles m’ont expliqué plus tard que si elles se joignaient à une telle manifestation, leur mari divorcerait et leur père les battrait. Je me suis donc rendue compte très jeune que les choses n’étaient pas faciles à changer et que viendrait mon tour pour l’enfermement dès le début de mon adolescence.
ÀB ! — Les conséquences de cette incarcération se lisent sur tous les visages des femmes ayant témoigné et qui appartiennent aux différentes générations. Quelque chose de pathétique se dégage : frustrations, dépressions et mélancolie. Avez-vous rencontré des difficultés pour arracher ces témoignages ?
N.Z. — Pour trouver des candidates pour le documentaire, j’ai essuyé beaucoup de refus. Les femmes me racontaient leurs histoires aussi tristes les unes que les autres, mais la difficulté se pointait quand je demandais la permission aux hommes de la famille. Dans ces sociétés, les femmes n’ont pas leur identité propre en tant que sujets autonomes : elles sont la femme, la fille, la sœur d’Untel. Pour les interviewer, il faut donc avoir la permission des hommes de la famille.
Cependant, dès que j’ai ouvert la caméra, ces femmes, comme des volcans, se sont livrées à cœur ouvert comme si on leur donnait la parole pour la première fois. Je n’ai eu aucune difficulté à les faire parler. Il y a effectivement une frustration, le sentiment de s’être faite avoir par des coutumes ancestrales qui n’ont plus de sens.
ÀB ! — Les hommes ayant répondu à vos questions semblent mis au pied du mur ou démasqués. Est-ce l’effet de la caméra ou est-ce que les hommes et les femmes convergent à expliquer par la fatalité le poids de toute cette tradition patriarcale plus accentuée à la campagne et vécue comme impersonnelle et dépassant les sujets sociaux ?
N.Z. — Non, je n’ai pas mis les hommes au pied du mur, ce n’était pas mon intention. Je voulais donner la parole à des hommes qui soient assez honnêtes pour expliquer le poids des traditions et expliquer comment ils sont pris dans ce carcan insoulevable. J’étais avec une équipe de tournage composée de femmes québécoises et les hommes algériens deviennent particulièrement galants devant des Occidentales, mais étant Algérienne et connaissant bien la mentalité, j’ai fait attention de ne tomber ni dans le discours féministe à l’occidentale qui veut dénoncer ces hommes qui ne donnent aucune liberté à leurs femmes ni dans le discours galant qui embellit la réalité. Je suis très contente des hommes qui ont témoigné dans le documentaire. Je les trouve très courageux, car ils rendent aussi justice à la souffrance des hommes pris dans cette mentalité complexe et ancestrale.
ÀB ! — Vous montrez en même temps des femmes qui jouissent d’une certaine liberté comme cette femme vétérinaire. Ne pensez-vous pas que la société kabyle ou algérienne en général fonctionne à double vitesse, malgré l’islamisation d’en haut du pouvoir et l’islamisation d’en bas des islamistes ?
N.Z. — Il est vrai qu’on ne peut pas décrire la situation de la femme d’une façon homogène dans toute l’Algérie qui est un vaste pays plein de contradictions. D’un village à un autre, les réalités sont différentes. C’est pour cela que j’ai choisi Linda, la vétérinaire du village, pour illustrer ces contradictions. Linda a un père très ouvert qui a donné toute la liberté à ses sept filles. Elle se déplace seule, sillonne les fermes de la région pour offrir ses services de vétérinaire, mais elle a travaillé très fort pour se faire accepter dans sa société et elle s’est imposée grâce à son ingéniosité et à sa façon d’être comme elle le dit dans le film : « comme un homme »…
Chaque famille est différente : certaines familles laissent les filles étudier un peu ; d’autres les laissent finir leurs études mais ne les laissent pas travailler de peur que les hommes ne les demandent pas en mariage… Dans les familles comme celle de Linda, la femme est libre de travailler. On parle d’études et de travail, mais vivre sa féminité est une autre histoire !
ÀB ! — Dans ce documentaire, certaines femmes semblent consciemment ou inconsciemment reproduire les rapports de la domination masculine. Dans son étude menée en Kabylie exactement, Bourdieu attribue cette reproduction des rapports de domination au fait que l’« habitus sexué » (devenir homme ou femme) est déterminé par un inconscient foncièrement phallocentrique, d’où le pouvoir autohypnotique du masculin (La domination masculine, Seuil, 1998). Est-ce que vous confirmez la thèse de Bourdieu, contestée déjà par beaucoup de féministes ?
N.Z. — Je suis tout à fait d’accord avec cette thèse. Je crois qu’il y a un grand travail à faire sur les femmes, car elles sont souvent, sans qu’elles s’en rendent compte, formatées par la domination masculine. Dans la façon d’élever les enfants par exemple : les femmes donnent souvent des tâches ménagères aux filles et pas aux garçons ; elles responsabilisent les filles plus que les garçons ; elles sont beaucoup plus exigeantes avec les filles qu’avec les garçons. Toutes ces choses qui ne semblent pas si importantes ont un grand impact sur les enfants et sur leur conception des deux genres. Je crois que les femmes du monde entier n’ont pas fini de se débarrasser de la domination masculine.
ÀB ! — Dans la perpétuation de la domination masculine, quelle est, selon vous, la part du legs arabo-islamique qui s’est sédimenté sur une tradition méditerranéenne connue pour son machisme, considérant que le code de la famille [1] est inspiré à 100 % de la charia ?
N.Z. — Je crois que la monté de l’islamisme dans nos sociétés est un véritable pas en arrière pour les femmes, car il ne s’agit pas d’un islam de la foi, mais d’un islam politisé qui veut soumettre la femme à l’homme. Le plus triste de tout cela, c’est que ça marche. Dès qu’on brandit le drapeau de l’islam, les femmes acceptent tout. On n’y peut rien, c’est notre religion ! Cette nouvelle façon de penser renforce nos traditions patriarcales et maintient les femmes dans un statut de petites filles qui dépendent de l’homme.
Heureusement qu’il y a un mouvement de musulmanes féministes à travers le monde qui font un véritable travail de relecture du Coran et qui rejettent l’interprétation patriarcale du livre saint. Elles acceptent d’être soumises à Dieu, mais pas aux hommes et je crois que c’est un mouvement qui deviendra aussi important que les mouvements féministes d’ici.
ÀB ! — Avez-vous perçu un brin d’espoir chez les jeunes générations pour imposer une égalité de fait et en action ou des tentatives pour se frayer des lignes de fuite par-ci par-là ?
N.Z. — J’ai remarqué que la jeune génération de filles ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elles réussissent mieux à l’école que les garçons, elles sont de plus en plus nombreuses dans le monde du travail et occupent de plus en plus des postes souvent réservés aux hommes. Ces réussites, elles les payent cher, car il y a un mépris ou une frustration des hommes qui ne réussissent pas autant et qui leur mènent la vie dure dans le milieu du travail surtout. J’ai moins peur pour les générations plus jeunes, car avec l’Internet et les moyens de communication, la planète devient de plus en plus petite et donc l’influence des idées de plus en plus facile.
ÀB ! — Comment a été reçu votre documentaire ici au Québec surtout par la communauté kabyle, algérienne ou arabe en général ?
N.Z. — Il a été très bien reçu ici. Il a d’ailleurs gagné le prix Caméra au Poing octroyé par Droit et démocratie et Courrier international pour les films engagés dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Les gens sont très touchés par les témoignages de ces femmes magnifiques, par la beauté de la nature en Kabylie, la belle musique et le côté poétique et profond du documentaire. Cependant, beaucoup de gens de la communauté algérienne, surtout des hommes, ont rejeté ce film, souvent sans l’avoir vu. Ils se sentent directement attaqués par le documentaire. Le documentaire est réel, les témoignages de femmes qui souffrent d’enfermement encore aujourd’hui en 2006 sont réels. Il y a donc une dénonciation qui met beaucoup d’hommes et de femmes mal à l’aise. Des hommes qui ont des choses à se reprocher, le documentaire les met devant une réalité qu’ils n’aiment pas regarder de face, une souffrance qu’ils ignoraient aussi, car ils ne se sont jamais mis à la place des femmes.
ÀB ! — Que peut-on faire à partir d’ici pour aider ces femmes en détresse comme Tounsia qui vit juste sous la lumière du jour et qui n’a même pas les moyens de soigner une dépression qui ne dit pas son nom ?
N.Z. — Malheureusement, pas grand-chose, car on ne peut pas envoyer des ONG pour travailler avec les femmes de ces villages puisqu’elles sont de toute façon enfermées. De plus, comme dans la plupart des pays musulmans, le concept de féminisme à l’occidentale est automatiquement diabolisé et perçu comme prélude vers la débauche. Le changement viendra de l’intérieur avec le grand nombre de filles éduquées, mais les lois doivent changer le plus tôt possible pour permettre plus d’équilibre dans les relations entre les hommes et les femmes. Je crois aussi que les pays faisant affaire avec des pays qui donnent très peu de droits aux femmes, comme l’Algérie ou l’Arabie Saoudite, doivent exiger que les femmes aient plus de droits, comme ils le font avec la Chine pour les droits humains. Il y a beaucoup de conditions pour qu’un pays adhère à des organisations onusiennes. Je crois que l’ONU devra aussi exiger que les pays qui postulent pour adhérer à de tels organismes prennent leurs responsabilités en ce qui concerne les droits des femmes.
ÀB ! — Quels sont vos futurs projets ?
N.Z. — Toutes les injustices du monde me touchent, je suis très sensible à la situation des femmes et des enfants dans le monde, mais présentement les problèmes d’intégration des immigrants me touchent beaucoup. J’ai donc des projets en ce sens, mais rien de concret pour le moment.
[1] Le Code de la famille est le texte législatif imposé par le pouvoir algérien en 1984, sous la pression de l’islamisme montant, et légiférant en matière de mariage, de divorce et d’héritage. Des articles de ce code consacrent explicitement le statut mineur de la femme, la polygamie, le droit restreint pour les femmes au divorce et à l’héritage, etc. Son abrogation constitue la principale revendication des associations de femmes depuis les années 1980. En Tunisie, la polygamie a été abolie en 1956 avec l’arrivée de Habib Bourguiba au pouvoir.
Article publié dans la revue À Babord, N° 18 – février-mars 20107